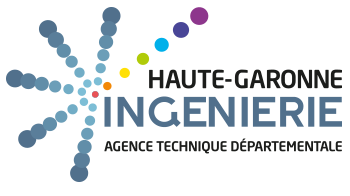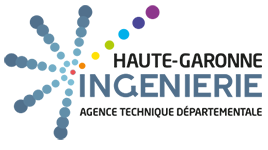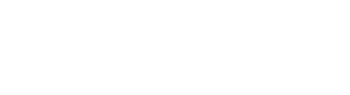Transport à la demande : une compétence initialement dévolue à la région pouvant être déléguée aux EPCI
En vertu de l’article L.1231-3 du Code des transports, la Région est l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) à l’échelle régionale. À ce titre, elle est responsable, pour les services d’intérêt régional, de l'organisation des transports publics réguliers et à la demande, ainsi que des services de transport scolaire. La loi d’orientation des mobilités (LOM) n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 a offert aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) la possibilité de délibérer pour prendre en charge les services de transport régionaux sur leur territoire. Toutefois, dans la pratique, de nombreux EPCI n’ont pas souhaité exercer cette compétence, laissant ainsi la Région en charge de ces services.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1231-4 du Code des transports, la Région peut, par convention, déléguer toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services de transports précédemment énumérés à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, mais aussi un EPCI à fiscalité propre.
A ce titre, la Région Occitanie a délégué la compétence « transport à la demande » (TAD) à plusieurs communautés de communes présentes sur son territoire.
Le service TAD et sa possible délégation aux EPCI
Le code des transports pose une définition du TAD : « les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers dont les règles générales de tarification sont établies à l’avance et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de quatre places, y compris celle du conducteur » (article R3111-2). Ainsi, comme le souligne le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), les services de TAD sont des services qui fonctionnent à la demande des usagers, ils ne se déclenchent que sur réservation de ces derniers et se distinguent des services réguliers de transport.
Lorsque la Région délègue, par convention, cette compétence à une communauté de communes, l’EPCI devient alors autorité organisatrice de la mobilité de second rang (AO2).
L’exploitation du service de TAD peut être assurée en régie ou par une entreprise ayant conclu une convention avec l’autorité organisatrice. Cela peut prendre la forme d’une délégation de service public ou d’un marché public.
En toute hypothèse, l’AOM va prévoir, par convention et en accord avec l’AO2, les modalités d’organisation du service, à savoir la consistance du service (destination, horaires, jours de circulation, fréquences définies par l’AO2, …), les itinéraires et les points de prise en charge, les modalités de réservation, le tarif, …
Les règles juridiques et financières applicables à l’exercice de la compétence TAD
Aux termes de l’article L.1221-3 du Code général des impôts : « L'exécution des services publics de transport de personnes réguliers et à la demande est assurée […] soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec l'autorité organisatrice ». Le service de TAD est ainsi un service public industriel et commercial (SPIC) défini comme tel par la loi. Ce dernier obéit à des règles de gestion financière et comptable qui leur sont propres.
L’article L.2221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes, et par extension les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère industriel ou commercial. L’autorité exerçant la compétence TAD dispose ainsi d’un choix dans le mode de gestion du service. La gestion directe de ce service entraine l’obligation de créer soit une régie disposant de la seule autonomie financière, soit une régie à personnalité morale et autonomie financière (article L.2221-4 du CGCT). La création de cette régie doit faire l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante qui devra également prévoir le montant initial alloué à la régie.
Les SPIC doivent inscrire leurs opérations dans un budget annexe spécifique, conforme à la nomenclature budgétaire et comptable M4, car ils sont tenus de s'équilibrer en recettes et en dépenses, quel que soit leur mode de gestion (concession, affermage ou régie), conformément à l’article L.2224-1 du CGCT. En principe, seules les trois exceptions prévues par l’article L.2224-2 du CGCT permettent de déroger à cette obligation.
Néanmoins, l’article L.1221-12 du Code des transports ajoute que le financement de ce type de service, outre le fait qu’il soit assuré par les usagers, peut également l’être, « le cas échéant, par les collectivités publiques ». Aussi, par dérogation aux règles classiques de financement des SPIC, la collectivité gestionnaire du service de TAD peut prendre en charge le déficit de l’exploitation de son service par son budget principal.
Des coûts à identifier selon les particularités du territoire
L’exercice de la compétence TAD génère des dépenses d’investissement et des charges de fonctionnement qui doivent être correctement identifiées et quantifiées selon les besoins spécifiques aux territoires d’exercice.
Ainsi, l’achat de matériel roulant (le véhicule jugé le plus adapté à cette compétence), la mise en place d’un système de gestion des réservations et des itinéraires, l’aménagement des points d’arrêt, les études éventuelles, ainsi que le choix des supports de communication (site internet, etc.) constituent autant de dépenses d’investissement dont il faudra anticiper et estimer le coût.
De même, de nombreuses charges de fonctionnement sont générées par l’exercice de la compétence : l’entretien et les frais de fonctionnement du ou des véhicules (réparations, assurance, carburant, …), les coûts liés au personnel, qu’il s’agisse des conducteurs ou de ceux chargés des problématiques de logistique (gestion des réservations, …).
A noter que le CEREMA a collecté des retours d’expérience sur la mise en place de ces services de TAD et sur le caractère variable des coûts selon les territoires.
L’épineuse question du financement de la compétence TAD
Selon la fabrique des mobilités, la prestation de TAD a un coût relativement élevé, de 15 à 25 € la course selon les territoires. La tarification du TAD est donc un enjeu crucial. Elle doit être en adéquation avec les objectifs fixés lors de la mise en place de ce type de service (désenclavement, public ciblé, motifs des déplacements, zone desservie, etc.) tout en maintenant un prix cohérent incitant à une utilisation raisonnée du service. Dans le cadre de la convention de délégation de la compétence TAD par la Région Occitanie, un prix va être arrêté en accord avec l’AOM et l’AO2.
Ce tarif, qui ne devra pas être prohibitif, ne permettra de couvrir qu’une très faible proportion du coût du service (environ 10 à 15 %). Si la Région s’engage à assumer le financement de façon bipartite, participant à un pourcentage, défini par convention, du déficit réel d’exploitation du service, d’autres sources de financement devront être trouvées pour limiter l’impact sur le budget principal de l’AO2.
L’AOM peut bénéficier du versement mobilité après le vote d’une délibération indiquant les services qu’elle souhaite organiser afin de justifier ce taux qui s'appliquera aux employeurs d’au moins 11 salariés sur l'ensemble de son ressort territorial (articles L.2333-64 et suivants du CGCT). Néanmoins, la possibilité de lever cette contribution spécifique n’est offerte qu’aux AOM organisant des services réguliers de transport. En effet, comme le rappelle un rapport du Ministère de la transition écologique et solidaire, dans les cas où une communauté de communes ne souhaite pas organiser de services réguliers, elle ne peut pas utiliser la ressource fiscale dédiée que constitue le versement mobilité.
De même, l’autorité organisatrice du service ne peut avoir recours au mécanisme du mécénat, le service de TAD ne pouvant être considéré comme une œuvre ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel […] au sens de l’article 238 bis du CGI.
Face à ces difficultés de financement, certaines collectivités organisant aujourd’hui ce type de service recourent au parrainage (ou sponsoring), défini comme un « soutien matériel apporté à une manifestation, une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct » (arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière). La manifestation principale de ce recours au parrainage est l’utilisation du flocage des véhicules par l’apposition d’encarts publicitaires sur les véhicules destinés au transport de voyageurs à la demande. En effet, de nombreuses entreprises proposent aujourd’hui de fournir des véhicules dont la location est financée par les recettes publicitaires. Le juge administratif a néanmoins pu juger que ce type de contrat de mise à disposition de véhicule, en contrepartie d’un loyer et d’un abandon de recettes publicitaires, était constitutif d’un marché public. Aussi, les collectivités souhaitant avoir recours à ce type de prestations doivent se montrer vigilantes quant au respect des règles de la commande public.
Enfin, le rapport ministériel précité évoque d’autres sources de financements auxquelles une AO2 peut avoir recours :
- des dispositifs de soutien de l’État existent et peuvent être sollicités sur ces problématiques : la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), les contrats de plans Etat-Région (CPER), la dotation d’équipement des territoire ruraux (DETR), la dotation politique de la ville (DPV) ou encore les subventions pour travaux divers d’intérêt local,
- des appels à projet et manifestations d’intérêts thématiques portés par l’État, ses opérateurs ou certaines collectivités territoriales,
- les programmes « certificats d’économie d’énergie » pour lesquels des vendeurs d’énergie contribuent financièrement à la mise en œuvre de solutions de mobilité sur les territoires,
- les offres de financement de la Banque des territoires (offre de crédits d’ingénierie, prêt aux collectivités, investissements financiers dans des partenariats publics-privés).
Néanmoins, ces ressources sont, pour la plupart, des recettes d’investissement liées à des projets spécifiques. La question du financement des charges de fonctionnement induites reste un enjeu majeur à ce jour. Un rapport du Sénat pointe d’ailleurs la difficulté du financement de la mobilité dans les zones rurales. Ce dernier, soulignant que le versement mobilité a été conforté comme pilier du système de financement, mais rappelant l’impossibilité pour les AOM n’instituant pas de service régulier de transport public de le mettre en place, pointe le fait que la loi d’orientation des mobilités (dit LOM) a laissé en suspens la question du financement de l’exercice de la compétence en zone rurale.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.