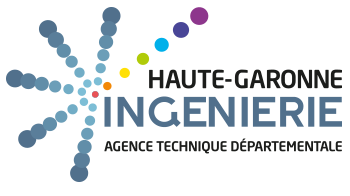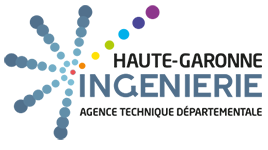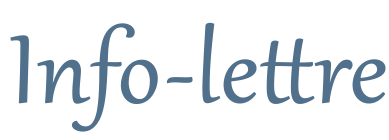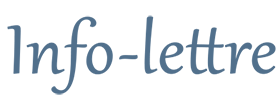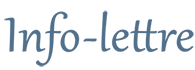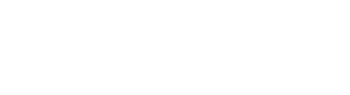La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances : un bilan 20 ans après
L'ambition de cette loi était de garantir les conditions de l'égalité et des chances pour tous les citoyens, notamment aux personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap.
La réalisation de ces objectifs s'articule autour des axes suivants :
- La compensation : il s'agit ici de mettre en place des aides personnalisées ( prestation de compensation du handicap, aides humaines et techniques) pour compenser les conséquences du handicap et garantir une réelle autonomie.
- L'accessibilité et une participation à la vie sociale : l'objectif est de rendre accessible aussi bien les transports, les infrastructures que le numérique mais aussi d'assurer l'inclusion des personnes en situation de handicap que ce soit en milieu scolaire ou professionnel. L'accessibilité est par ailleurs, inscrite comme principe fondamental dans la loi.
- La simplification des démarches et accompagnement des personnes et de leurs familles. Pour y répondre des dispositifs ont été créés, comme la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
A l'occasion des 20 ans de cette loi, des bilans ont été dressés, notamment par le ministère du travail de la santé, des solidarités et des familles en ligne sur handicap.gouv.fr , et par la défenseure des droits : https://www.defenseurdesdroits.fr/.
Si ces bilans constatent les améliorations apportées par cette loi, ils relèvent néanmoins les nombreuses difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs initialement fixés.
Ainsi, par exemple, en matière d'accessibilité, la loi de 2005 avait prévu que les établissements recevant du public (ERP) devaient répondre à cette exigence dans les 10 ans. Or, en 2015, seule une partie des ces ERP remplissaient ces caractéristiques. Partant de ce constat et de l'impossibilité de tenir ces délais les agendas d'accessibilité programmé (Ad'AP), ont été mis en place. Ce dispositif a permis à 7000 000 de ces établissements d'entrer dans cette démarche et à 350 000 d'être déclarés accessibles. En dépit de cette avancée, 900 000 ERP ne sont toujours pas engagés dans cette mise en accessibilité.
Le texte de 2005 prévoyait également, l'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements de espaces publics (PAVE) (article 45). Mais ce plan ne s'impose qu'aux communes de plus de 1 000 habitants. Or, 54 % des communes comptent moins de 500 habitants. Il en résulte donc que de nombreuses collectivités ne sont pas tenues de les élaborer. Face à cette situation, "La Défenseure des droits recommande d'inscrire dans la loi l'obligation pour les autorités compétentes de prévoir un programme de la mise en accessibilité de la voirie".
La loi avait aussi instauré l'obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne des "organismes du secteur public" (article 47). Mais l'objectif fixé des 50 % d'accessibilité est encore loin d'être atteint, à ce jour seuls 5 % de sites internet répondent à 100 % d'accessibilité.
En matière d'inclusion scolaire, il apparaît aussi que des progrès ont été accomplis. En effet, "Le développement des accompagnants d’Élèves en situation de Handicap (AESH) a constitué une avancée importante pour offrir un soutien adapté aux élèves Par ailleurs , le nombre d'unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) a considérablement augmenté, permettant à davantage d'élèves de suivre un cursus adapté à leurs besoins".
L'investissement dans ce domaine a permis à 520 000 élèves en situation de handicap d'être scolarisés en milieu ordinaire contre 130 000 en 2005. Le nombre d'accompagnants reste malgré tout insuffisant et des inégalités existent entre les territoires.
De plus, il est à noter qu'afin de favoriser l'inclusion scolaire, notamment durant la pause méridienne, et de revenir à l'esprit initial du texte de 2005, la loi du 27 mai 2024 a prévu la prise en charge financière des accompagnants des enfants en situation de handicap (AESH) par l’État durant la pause méridienne. Pour en faciliter l'application, un décret n°2025-137 du 14 février 2025 est venu clarifier le cadre d’intervention des AESH pendant le temps de pause méridienne. Ce décret est présenté dans cette Infolettre : "Intervention des AESH sur la pause méridienne :un décret apporte des clarifications".
Concernant les dispositifs mis en œuvre pour simplifier les démarches administratives, le bilan relève que les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ont permis de centraliser les demandes d'aides et de faciliter l'accès aux prestations et aux droits des usagers. Le délai de réponse des MDPH demeure toutefois encore trop long.
Enfin, les bilans relèvent que si la prestation de compensation du handicap (PCH), accordée aux personnes dont le handicap survient avant 60 ans, a permis de répondre à un besoin humain (aidants aux familles...), d'apporter une aide technique ou encore d'être affectée à l'aménagement du logement, elle présente néanmoins des limites. En effet, cette prestation ne couvre pas l'ensemble des besoins comme ceux nécessaires à la vie sociale. Les tarifs de l'aide techniques apparaissent également insuffisants pour couvrir les coûts d'acquisition des matériels adaptés, laissant un reste à charge trop important pour les bénéficiaires.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.